-
"Un voyage dans le Châtillonnais au XVIème siècle", une notule d'Histoire passionnante de Dominique Masson
Par Christaldesaintmarc dans -Les "Notules d'histoire" de Dominique Masson le 4 Novembre 2022 à 06:00Dominique Masson nous présente une notule d'histoire passionnante :
Un voyage dans le Châtillonnais au XVIe siècle: le récit de l’ambassadeur vénitien Jérôme Lippomano
Jérôme (Girolamo en italien) Lippomano appartient à une famille patricienne de Venise (Lippomano, Lipomani ou Lippoman), originaire de Negroponte (île grecque d’Eubée), et fut agrégée à la noblesse vénitienne à la suite des services offerts par l’un de ses ancêtres.
Né en 1538, il est issu d’une famille de banquiers; il sera considéré comme l’un des plus habiles politiciens de sa région et se fera nommer ambassadeur auprès de plusieurs cours européennes tout au long de sa carrière.
En 1577, il fut nommé ambassadeur de Venise auprès du royaume de France.

(Figure 1 : Armes des Lippoman : de gueules à une bande d'argent avec deux têtes de lions arrachées de même, posées en pal)
Avec sa suite, il se rendit,par voie terrestre,auprès du roi de France Henri II.
Son secrétaire fit la relation de ce voyage, assez mouvementé car, à cette époque, la France était en proie à une guerre civile entre catholiques et protestants, guerre commencée en 1562.
L’ambassadeur fait donc son voyage en traversant un pays où alternent guerres et périodes de paix relative, mais où circulent de nombreuses bandes armées. Ce récit, Voyage de Jérôme Lippomano, ambassadeur en France en 1577, par son secrétaire, fut traduit, avec d’autres, en français, en 1838 [i].
Mais M. Charles Rouhier, docteur à Grancey-le-Château et originaire de Recey, historien et archéologue, en avait aussi demandé une traduction, en 1863, à un autre historien local, M. Gaveau, de Magny-Lambert [ii].
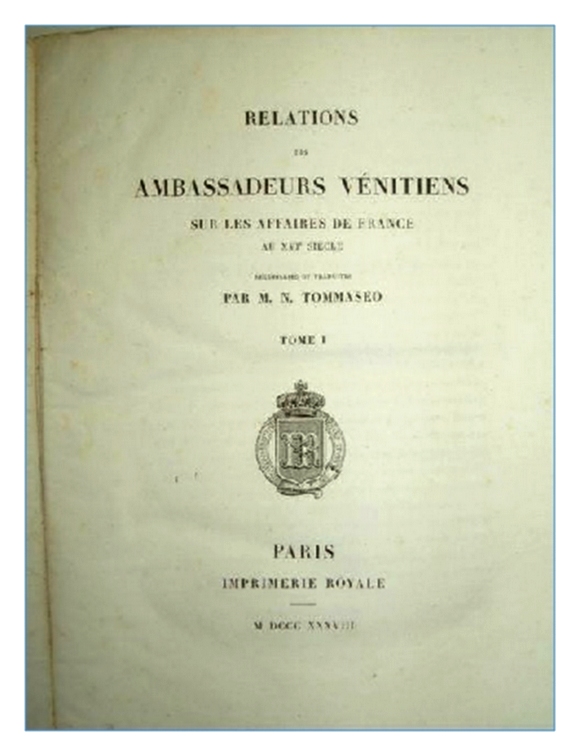
(Figure 2 : relations des ambassadeurs vénitiens par M.Tommaseo Paris 1838)
Parti de Venise le 4 février 1577, l’ambassadeur passe à Lodi, Alexandrie, Asti, Moncaliero, Turin, puis arrive à Suze, un pays renommé par les bons vins qu’on y fait et qui s’exportent en grande quantité, par toute la Savoie.
Avant de traverser le Montcenis, il couche dans un petit village dont il dit:
C’est un pays tout à fait stérile, ne produisant ni grain, ni vin. Aussi, les pauvres habitants mourraient-ils de faim, sans la foule innombrable de voyageurs qui y passent chaque jour, pour aller en Italie, en France, dans la Flandre, en Angleterre, et même en Espagne.
Le 15 avril, Lippomano se trouve au Montcenis :
La neige, en certains lieux, était si peu résistante, que les chevaux et les mulets s’enfonçaient jusqu’au poitrail et qu’on avait peine à les dégager.
A Lunebourg [i], c’est un miracle de trouver quelque chose, puisque, disent les paysans eux-mêmes, le soleil n’y paraît guère que trois mois de l’année.
La contrée est réellement misérable, comme presque toute la Savoie, principalement jusqu’à St Jean de Maurienne. Après avoir vu Chambéry et Aix les Bains, Lippomano entre à Belley le 23 avril.
Tandis que nous discourions sur ce qu’il y avait de plus sûr, ou de prendre la grande route de Bourgogne, pour éviter La Charité, ou d’aller à Roanne pour nous embarquer sur la Loire, nous apprîmes que des Provençaux, gens nés pour mal faire, postés entre Tarare et Roanne, nous attendaient sur le chemin, demandant aux voyageurs s’ils ne nous avaient pas rencontrés.
Par ce motif, M. l’ambassadeur, craignant aussi de ne pouvoir éviter les détachements de l’armée qui s’était déjà débandée après le siège de La Charité, prise en ce moment-là, résolut de se diriger vers la Bourgogne [ii]…
Il passe la Saône sur un bateau et s’arrête à Mâcon, où il trouve le logement confortable, mais d’un prix trop élevé.
Le 28, il s’embarque sur la Saône et, deux jours après, arrive à Chalon, dont on construisait la citadelle; il vante la position avantageuse et le mouvement commercial de cette ville :
Chalon est une belle, grande et forte ville, ornée d’un riche hôpital, de belles églises, de beaux édifices, de deux ponts superbes.
Le pays est riche en vins et en blés.
Entre Chalon et Beaune, il y a des bois très peu sûrs et la route est dangereuse.
Le 30, les voyageurs arrivent à Antigny et se rendent à Beaune, dont ils admirent l’hôpital.
L’hôpital de Beaune est peut-être le plus riche de France ; il y a des appartements pour loger le roi, la reine et les princes de sang.
Nous logeâmes dans les faubourgs, à l’hôtel St Nicolas, où nous fûmes assez convenablement ; le maître d’hôtel et sa femme furent très raisonnables.
Entre Beaune et Dijon, où nous entrâmes le Ier mai, on remarque deux châteaux avec deux terres qui en dépendent, terres ruinées peu auparavant par les Reîtres; il s’agit de Nuits et Arzili [iii] ; ces châteaux furent saccagés et détruits, comme presque tout le pays voisin, à l’exception de la ville et des grosses terres murées, par les Reîtres, il y a deux ans.
Dijon est la capitale de la Bourgogne; c’est là que sont jugées toutes les causes du pays, ou d’après la volonté des parties, ou bien en dernier ressort.
On y construit en ce moment un édifice pour le Parlement; ce bâtiment sera superbe par son architecture noble et sévère, par la richesse des ornements et la beauté de ses statues.
Elle renferme de nombreuses, grandes, riches et belles églises; la cathédrale, en particulier, est regardée comme une des plus belles de France, sinon des plus grandes; elle a une des 3 saintes chapelles de France, laquelle est bâtie avec luxe, plus une collégiale, dont les chanoines, gouvernés par un doyen, sont indépendants de l’évêque du lieu…
Cette ville a 4 portes et 33 tours, aujourd’hui pleines de terre…
A côté, passe un ruisseau qui va se jeter dans la Saône; les gens du pays l’appellent Saluzze [iv].
Le premier magistrat de la ville de Dijon (car je ne compte pas ici le parlement) s’appelle maire, comme dans toutes les villes de la Bourgogne et dans plusieurs provinces de France.
Il est élu chaque année par ses concitoyens, dans la classe des nobles ou des bourgeois; il a une garde de hallebardiers et son autorité n’est pas sans importance.
Etant allé chez lui, comme je le fais partout où je passe, je le priai très poliment de me donner, avec les certificats ordinaires de santé, un passeport qui, émanant de la capitale de la Bourgogne, pût me servir pour les autres localités, afin que personne ne mit obstacle au voyage de M. l’ambassadeur; je lui donnai à entendre qu’il ferait ainsi une chose agréable à sa majesté.
Le bon homme (pour ne pas l’appeler autrement), fit des difficultés, doutant réellement que ce fût l’ambassadeur de Venise, et ajouta: c’est sans doute quelque particulier qui prend ce titre.
Comme je lui montrais en pure perte les lettres patentes de la seigneurie sérénissime, de son excellence Mgr le gouverneur de Milan, du duc de Savoie et du très puissant seigneur le gouverneur de Lyon, il finit par me dire: comment ce gentilhomme peut-il être ambassadeur de Venise, s’il est vrai que tout le monde y est mort de la peste l’an dernier et qu’il n’en est pas resté un seul vivant ?
Je lui représentai que le fait était inexact et qu’il n’était guère mort dans cette ville que 40 à 50 mille personnes tout au plus [v].
Eh! bien, n’ai-je donc raison?reprit-il; je me figure précisément qu’il doit être resté très peu de monde.
Je me vis obligé de lui répondre que la mort de milliers de personnes à Venise laissait moins de vide que des dizaines à Dijon.
Il demeura déconcerté de cette réponse et, comme je témoignais le désir de partir, disant qu’après tout, je ne me souciais plus guère de son passeport (et que j’en informerais le roi), il m’en fit délivrer un en bonne et due forme.
Le soir du 2 mai, nous arrivâmes à Saint-Seine, abbaye et pays entouré de murs, bien que peu important, à 5 lieues de Dijon, cheminant toujours au milieu des vallées et des collines, comme l’on fait presque continuellement jusqu’en Champagne.
La route toutefois n’est pas bien fatigante ni dangereuse; elle est même bonne et presque toute en plaine, offrant de 2 lieues en 2 lieues des villages qui, ruinés ces années dernières par les Reîtres, se garnissent maintenant d’une enceinte de murailles et de fossés, aux frais des communes et du consentement du roi.
St Seine a une église dont on a fait en quelque sorte une forteresse, mais peu considérable parce qu’elle est enfoncée dans la vallée.
Cependant les gens du pays y placent, comme en lieu sûr, ce qu’ils ont de plus précieux.
Ils ont à craindre, non seulement les dépravations des Reîtres, quand il en passe, mais aussi les gens d’armes qui s’établissent souvent à discrétion, tout catholiques qu’ils sont, comme l’avaient fait la veille 6 enseignes d’infanterie et 6 de cavalerie, conduits par le fils du gouverneur de Metz et qui allaient rejoindre Mgr d’Alençon, frère de sa majesté très Chrétienne, lequel se dirigeait du côté de l’Auvergne, après la prise de La Charité.
Cette nuit-là, nous logeâmes à l’enseigne des Sceaux, assez bien eu égard à la localité et, le 3, laissant d’abord Chanceaux, village ouvert, puis Baigneux, terre nouvellement fortifiée, le Ier à deux lieues, le second à 4 lieues de Saint Seine, nous arrivâmes le même soir à un petit château appelé Saint-Marc, que nous eûmes de la peine à atteindre de jour, à cause des détours du chemin qui se perd dans les bois plus épais qu’étendus.
C’est ce qui fit que notre troupe, s’étant égarée, les uns d’un côté, les autres de l’autre, nous fûmes aperçus par des voleurs qui nous suivirent pendant plusieurs jours, comme je le dirai plus loin.
Cette partie de la Bourgogne est fort stérile car, de Dijon à Saint Marc, on voit peu d’arbres, excepté près des villages; les vignes y sont également très rares.
Cette nuit-là, nous logeâmes à l’hôtel St Georges, où nous fûmes assez mal.
Le lendemain matin 4, nous partîmes, et chevauchant toujours près de la Seine, au milieu de vallées très agréables, nous arrivâmes à Aisey le Duc, laissant d’abord Brémur, tous deux châteaux fortifiés et peu éloignés.
Non loin de là, on trouve un grand mur, large de plus de 3 pas et long d’au moins 25 qui, barrant l’extrémité de la vallée, interrompt le cours de la Seine, obligée de passer à travers de faibles coupures, pour former de l’autre côté du mur de petits ruisseaux fort agréables: les fontaines amoureuses.
Ce même soir, nous arrivâmes à Châtillon-sur-Seine, à 4 lieues de Saint Marc.
Châtillon, ville assez importante, n’est pas fortifiée ; le peu de murailles qu’elle avait fût jeté à terre par l’amiral Coligny, quand il la prit [vi] ; le château, situé sur la hauteur et dont les ruines attestent une ancienneté plus reculée, ne se compose que de tours très élevées, avec de grosses murailles, toutes d’excellente pierre.
Ces ruines indiquent une habitation tout-à-fait royale et somptueuse.
Au pied du rocher, jaillit une source qui, à 5 ou 6 pas de distance, devient (chose presque incroyable !) un ruisseau assez abondant pour faire marcher 4 grandes roues de moulin.
Néanmoins, la Seine n’est pas navigable, bien qu’elle s’élargisse un peu. Nous fûmes très heureux de ne pas continuer notre route ce jour-là; sans cela, nous étions morts, ou au moins dévalisés, comme je le rapporterai tout à l’heure.
Nous nous arrêtâmes donc pour voir la ville, qui est assez belle et assez grande et fut jadis la résidence des ducs de Bourgogne; ce fût même par un effet de la miséricorde divine, qui nous délivra d’un grand péril.
Car, tandis que nous étions à table, dinant à l’hôtel du Lion d’or, maison confortable où les prix sont modérés, arriva un voyageur à pied qui avait fait la même route que nous.
En entendant quelques-uns de notre compagnie parler italien, il comprit qui nous étions et dit:
«Si, comme je le pense, vous êtes vénitiens, je vais vous apprendre une agréable nouvelle.
En passant aujourd’hui près d’Aisey le Duc, près des Fontaines amoureuses, 4 cavaliers m’ont demandé si j’avais vu 5 mulets avec la couverture rouge d’un ambassadeur vénitien ».
Comme je leur répondis négativement, ils se dirent: «certainement ils se sont égarés, mais nous les retrouverons vers Mussy-l’Èvêque [vii] »; et, s’éloignant de moi, ils se jetèrent dans un bois voisin.
Peu après, arriva aussi à l’hôtel un laquais du grand écuyer du roi, que son maître envoyait de Villars le Poitiers [viii] à Dijon, lequel, apprenant que M. l’ambassadeur y était logé, nous raconta qu’à une lieue et demie de Châtillon, il avait vu une troupe d’environ 25 cavaliers passer la Seine à gué; l’un d’eux, armé et bien monté, s’étant approché de lui, lui avait demandé s’il avait rencontré plusieurs mulets avec des housses rouges; ce laquais le regardait comme l’espion d’une bande de voleurs (car les français nomment ainsi certains gentilshommes pauvres qui battent les grands chemins et se retirent ensuite dans leurs maisons ou châteaux).
Averti de ce danger, j’allai, d’après l’ordre de M. l’ambassadeur, en conférer avec le lieutenant du roi, dont l’autorité est supérieure à celle du maire, et je le priai de vouloir bien, en se conformant aux ordres de sa majesté, nous donner une escorte de gens de pied et de cavaliers, pour nous conduire en sûreté jusqu’à Bar-sur-Seine.
«J’ai été averti, me dit-il, que ces brigands ont passé le rivière à gué, qu’ils ont logé cette nuit dans un village à une lieue d’ici et qu’ils sont postés pour vous attendre au passage.
Je vous conseille, ajouta-t-il, d’attendre un ou deux jours; le duc de Mercœur, cousin du roi, doit passer avec deux cents chevaux [ix]; on l’attend aujourd’hui à Châtillon.
M. l’ambassadeur pourra aller de compagnie avec lui, ou bien attendre qu’il ait passé, car il balaiera le chemin ».
Le duc arriva mais, changeant d’avis, au lieu d’aller à Paris, il prit à gauche pour aller rejoindre le frère du roi, qui s’était retiré en Auvergne avec son armée, après avoir pris La Charité.
Ainsi, force nous fut, le 7 du mois, de prendre une escorte de douze cavaliers et de vingt-quatre arquebusiers, qui nous menèrent sains et saufs à Bar-sur-Seine…
De Châtillon, nous arrivâmes à Courcelles, puis à Villars le Poitiers[x], château situé à une lieue et demie de distance; et nous eûmes de plus fraiches nouvelles de nos voleurs que, du haut de la muraille, on avait vu passer dans le voisinage.
Nous continuâmes sans défiance notre route jusqu’à Mussy-l’Èvêque, où nous dinâmes.
C’est une petite ville assez belle et fortifiée, avec de beaux jardins, des étangs et un superbe bâtiment pour le logement de l’évêque; bien qu’elle soit encore en Bourgogne, elle dépend de la Champagne pour la juridiction.
Nous passâmes ensuite à Courteron, Giey sur Seine, Neuville, tous gros villages nouvellement fermés de murs par leurs habitants… Enfin, nous arrivâmes sans accident à Bar sur Seine.
Là, ils prendront une nouvelle escorte de cavaliers et arquebusiers, avec le prévôt de Troyes en tête.
Puis ils arrivèrent le 22 mai à Amboise, où l’ambassadeur fut reçu le 24 en audience publique; il put présenter ses lettres de créance et fit la révérence au roi.
Lippomano et sa suite restèrent ensuite, depuis le mois de juin, pendant trois mois, à Poitiers [xi], où se trouvait la cour, car le roi voulait être au plus près des troupes qui assiégeaient Brouage.
Après l’édit de Poitiers, le roi et la cour regagnèrent Paris et Lippomano les suivit.
Dans ses rapports adressés à Venise, l’ambassadeur, après avoir évoqué les questions diplomatiques, donna un témoignage amusant du goût des Français, et plus particulièrement des Parisiens, pour la nourriture.
Deux fois par semaine, les mercredis et samedis, la capitale était ravitaillée par un cortège de plus de deux cents chevaux qui traînaient des charrettes pleines de victuailles: céréales, légumes, viandes, poissons et autres bêtes vivantes.
Le tout aurait été vendu en moins de deux heures.
L’ambassadeur note que le veau n’était guère plus cher que le mouton, tant il y en a.
Le porc, moins recherché, était la viande du pauvre.
Le chevreuil aurait eu la préférence sur tous les gibiers et l’ambassadeur semble surpris que le lièvre et le marcassin passent avant la perdrix ou le faisan.
Il est fasciné par l’abondance du poisson qu’il juge toutefois de moins bonne qualité qu’en Italie.
Foisonnent la sole, l’esturgeon, le turbot et les huîtres qu’on trouve presque toute l’année.
Car les Parisiens préféraient les poissons de mer, surtout l’hiver lorsque le transport le permettait.
Parmi les poissons de rivière, il cite le brochet, la grosse lamproie et le saumon que l’on pêche aux embouchures de la Loire et de la Seine.
Quant à la carpe, elle n’aurait été consommée qu’en pâté.
Il remarque que les Parisiens n’ont guère de goût pour les légumes, sauf pour les pois verts, ni pour les fruits.
La fin de vie de Jérôme Lippomano sera tragique.
Alors qu’il était ambassadeur à Constantinople, en 1591, il est accusé par le Conseil des Dix de Venise d’avoir fourni à la cour d’Espagne de Philippe II des secrets sur les techniques de construction des navires.
Selon la version officielle, il se serait jeté dans la mer depuis le bateau qui le ramenait pour le juger.

(Figure 3 : carte de Bourgogne de Joan Blaeu (1596-1773) néerlandais, indiquant "Villers-les-Potier" pour Villers-Patras)
[i] Probablement Lans le Bourg
[ii] L’édit de Beaulieu avait été promulgué le 6 mai 1576 ; mais, en décembre 1576, commence la sixième guerre de Religion. Le parti catholique reprit La-Charité-sur-Loire, place de sûreté protestante, point stratégique pour le franchissement de la Loire. Finalement, ce fut la paix de Bergerac, en septembre 1577, confirmée par l’édit de Poitiers, qui mit fin momentanément à cette guerre.
[iii] Arzilles ?
[iv] Ce doit être le Suzon qui se jette dans l’Ouche, laquelle rivière amène ses eaux à la Saône
[v] Selon Muratori, cette peste de 1576 emporta 22 000 hommes, 37 000 femmes et 11 000 enfants
[vi] En 1562, la guerre éclata entre le parti catholique et le parti protestant ; l’amiral de Coligny s’engagea auprès du prince de Condé, qui tenait pour le protestantisme. Le prince, avec Jean-Casimir du Palatinat, passa avec ses troupes près de Châtillon en 1576, mais il ne prit pas la ville. C’est au contraire l’époque où, à partir de 1571, de grands travaux de fortification y furent entrepris. Quant à Coligny, il avait pris, en 1570, La Charité sur Loire, qui devint l’une des quatre places fortes du protestantisme
[vii] Mussy-sur-Seine (Aube)
[viii] Villers-Patras
[ix] Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur et de Penthièvre, devint beau-frère du roi Henri III, lorsque celui-ci épousa sa sœur ainée, Louise de Vaudémont, en 1575
[x]Villers-Patras
[xi] L’édit de Poitiers fut signé le 17 septembre 1577, mettant fin à la sixième guerre de religion
[ii] Archives départementales de Côte d’Or : 201 J, article1
-
Commentaires
en Bourgogne
