-
"Si les truites pouvaient parler", une conférence passionnante sur la gestion des rivières en Châtillonnais, par Pierre Potherat
Pierre Potherat vient de publier un ouvrage très intéressant sur l'état critique de nos rivières, intitulé "Si les truites pouvaient parler".
Il a présenté une conférence sur ce sujet lors de l'Assemblée Générale de l'ARPOHC.
Je publie ci-dessous en vert, une grande partie du texte de sa conférence, et je l'ai illustrée par quelques photos de son livre (les diapositives projetées étaient trop pâles)
Bien entendu ce que vous allez lire dans cet article, n'est qu'une infime partie de ce que l'on peut trouver dans le magnifique livre de Pierre Potherat "Si les truites pouvaient parler, l'histoire récente des rivières du Châtillonnais".
Ce livre est en vente à l'Office du Tourisme, au prix de 13 €, une somme dérisoire au vu de son intérêt.
N'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes intéressés par les problématiques de l'eau en Châtillonnais, il est passionnant.
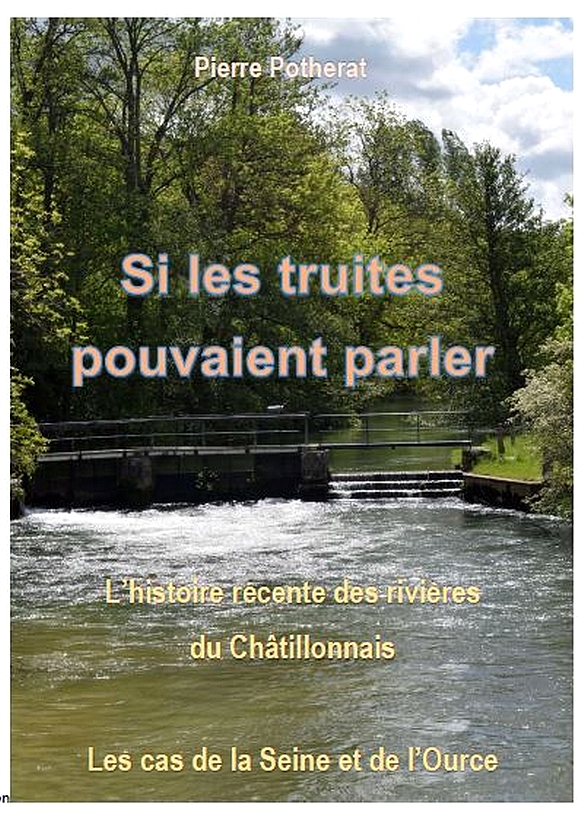


La conférence de Pierre Potherat a eu pour but de démontrer que les ouvrages hydrauliques n'ont jamais empêché les truites de se reproduire, mais aussi d'identifier les changements survenus depuis 60 ans sur nos rivières, de comprendre les conséquences de ces changements sur les populations de poissons, d'analyser la pertinence de l'application de la continuité écologique dans notre région et de montrer objectivement des premiers effets de la suppression d'ouvrages hydrauliques.
Cette conférence a abordé le problème de la gestion de l'eau de nos rivières et des eaux souterraines du Châtillonnais et en a tiré un bilan et une synthèse.
Cette conférence a été très appréciée par les adhérents de l'ARPOHC et le conférencier a été très applaudi.
Avant 1960, existaient dans le Châtillonnais de nombreuses installations artisanales et/ou semi- industrielles : moulins avec huileries, scieries, fourneaux, forges etc...munies d'ouvrages hydrauliques (densité de 1,5 à 3 au km)
La rivière était déjà aménagée mais avait gardé ses zones humides.

Avant 1960, les populations de poissons étaient abondantes :

Les niveaux d'eau étaient très élevés toute l'année
Mais depuis 1960, il y a eu de grands changements. On a effectué de grands curages. Ces travaux ont eu de grandes conséquences.
Les changements observés depuis 1960, dans l'ordre chronologique
-Les grands curages des années 60
-L'introduction de l'ombre commun au début des années 60
-L'alevinage en truites arc-en-ciel à partir des années 80-90
-L'arrivée du grand cormoran à la fin des années 90
-L'application de la continuité écologique et du débit minimum réservé dès le début du XXIème siècle
-L'apparition des écrevisses américaines à partir des années 2010
Il y a eu des effets à long terme sur le niveau de la nappe alluviale :
-Accroissement de la force érosive du courant ---> surcreusement du lit des rivières --> disparition de la vie présente dans les sédiments
-Atteinte aux zones humides --> dégradation des biotopes et des écosystèmes
-Destruction des refuges naturels (système racinaire exondé)

L'application de la continuité écologique a pour objectifs :
"La libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques."
Mais certaines eaux sont devenues stagnantes, plus chaudes à l'amont des ouvrages.
Bilan de l'application de la continuité écologique, sur le débit minimum réservé appliqué à Thoires,
-En 2015 la mort de plus de 200 truitelles dans le sous-bief ainsi que des grosses truites dans le bief amont, mais aussi des vairons, des lamproies.
-En 2017, une dizaine de truites adultes, plus d'un millier de chabots, des dizaines de lamproies, des épinoches ainsi que de très nombreux mollusques d'eau douce, une dizaine de brochets et des milliers d'alevins, piégés dans les petits trous d'eau périrent quelques jours plus tard
vous pouvez consulter ce lien qui relate l'étendue du désastre, c'était un article de Pierre Potherat, publié sur le blog en 2017 :
L'application de la continuité écologique a donné lieu à des effacements et des réalisations.
-Dans l'aire du Parc National des Forêts, 604 ouvrages ont fait l'objet d'un signalement
-Plus d'une vingtaine d'ouvrages importants ont été démantelés sur la Seine, l'Ource, la Digeanne.
Les résultats observables :
-Vitesse du courant accélérée -->"crues éclairs" et baisse significative de la cote du fil de l'eau --> la nappe alluviale ne se recharge plus.
-Ablation des sédiments, hôtes de microorganismes
-Poursuite du surcreusement de la rivière et baisse du niveau de la nappe alluviale
-Les effectifs de poissons continuent à baisser.
Bilan des actions récentes en terme de biodiversité
-Impact sur les biotopes et les zones humides
-Impact sur les population de poissons (cf pêche électrique)
-Impact sur les étangs forestiers (cf ru du Val des Choux)
Et pourtant la pluviométrie à Châtillon a été ...excédentaire !

La problématique de la gestion de l'eau, de l'intérêt des niveaux d'eau élevés dans les rivières
Les vannages et les biefs encore en fonctionnement sont les meilleurs alliés de la protection des zones humides, ainsi qu'en témoigne la photo prise à Thoires lors de la canicule de 2019.

En période de crue
Les rivières de notre région sont caractérisées par un lit mineur, dans lequel s'effectue l'écoulement en période de basses et moyennes eaux, et par un lit majeur, ou plaine inondable, occupé par les prairies.
En cas de fortes montées des eaux, celles-ci envahissent la plaine inondable qui joue un rôle de stockage naturel et et d'écrêteur de crue, car la vitesse des courants y est faible et l'eau lente à s'évacuer. Les localités situées en aval seront moins impactées.
Le débordement des rivières dans le lit majeur était autrefois facilité par par la position du niveau de l'eau, plus élevée qu'aujourd'hui d'environ un mètre. Il était également aidé par le fort taux de remplissage des retenues d'eau associées à des vannages et des biefs, jadis très nombreuses dans la région.
Il est souhaitable de favoriser ces débordements très en amont afin de bénéficier d'un épandage optimal sur l'ensemble du linéaire et le moins contraignant possible pour les populations.
Comment lutter contre les crues
La lutte contre les inondations peut s'opérer de deux manières qui peuvent être combinées pour plus d'efficacité :
-Stocker le maximum d'eau dans les alluvions
-Favoriser le débordement des rivières le plus en amont possible afin d'écrêter efficacement l'onde de crue.
-La plaine alluviale ne doit pas être occupée par des constructions.
Comment lutter contre les assecs
La lutte contre les assecs passe également par
-Le stockage de l'eau dans les alluvions et par sa restitution en période sèche
-La diminution du débit des cours d'eau, par réduction de leur gabarit.
Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de remonter la cote du fil de l'eau, ce qui entraînera de facto la remontée de la nappe alluviale et aura le mérite de faire d'une pierre deux coups.
Bilan -Synthèse
Il y a plus de 2 000 ans, les rivières du plateau de Langres étaient des rivières paresseuses à niveau lent qui formaient de larges méandres dans les vallées, avec un fil de l'eau proche de la cote de la plaine d'inondation.
Ce dispositif a favorisé les débordements, les changements de lit et les dépôts de sédiments de la plaine alluviale que nous connaissons aujourd'hui..
Les installations artisanales basées sur l'utilisation de la force hydraulique ont canalisé une partie des cours d'eau en amont des vannages et/ou dans les biefs,mais n'ont pas modifié la ligne d'eau de telle sorte que les zones humides ont été préservées.
Le chevelu hydrographique naturel a, en quelque sorte, été remplacé par un autre chevelu constitué de biefs, canaux,chenaux de délestage et de restitution associés aux fossés de drainage.
Ce chevelu de remplacement a longtemps joué un rôle de premier plan dans la recharge des nappes alluviales ainsi que dans le maintien des biotopes et des équilibres biologiques.
Le creusement de biefs par les anciens n'avait pas contribué à faire baisser le niveau de l'eau.
Avec les interventions humaines des années 60, les caractéristiques physiques des cours d'eau ainsi que celles des nappes phréatiques ont été considérablement modifiées.
Les lits mineurs, taillés dans les alluvions modernes, ont vu leur gabarit élargi,approfondi et canalisé par la suppression des méandres les plus marqués.
Ces modifications ont eu pour effet, en fonction de la saison, de vidanger les zones humides, d'accroitre le débit de crue des rivières et d'entretenir le surcreusement des lits mineurs jusqu'à aujourd'hui.
Cette dégradation s'est lentement poursuivie jusqu'aux années 2000 puis s'est accélérée avec la suppression des seuils et vannages depuis une dizaine d'années et nous pouvons conclure que ce que la nature avait mis des millénaires à construire, l'homme a réussi à le détruire en un peu plus d'un demi-siècle.
Après avoir lu les dix commandements des truites nous pouvons conclure :
-Que la baisse de la cote du fil de l'eau est la cause principale des problèmes rencontrés sur le réseau hydrographique du plateau de Langres et probablement sur nombre d'autres rivières de plaines.
-Que la priorité des priorités est de rehausser cette cote afin de revitaliser le réseau de chenaux, canaux et autres fossés de drainage nécessaires au bon fonctionnement des zones humides et de leurs biotopes.
-Que la sauvegarde de la truite sauvage de plaine,la gestion de l'eau et la préservation du petit patrimoine relèvent du même combat.
-Quand les conditions d'équilibre qui prévalaient autrefois seront à nouveau réunies, les écosystèmes recouvreront progressivement les caractéristiques faunistiques et floristiques que les plus âgés d'entre nous ont connues il n'y a pas si longtemps.
(Pierre Potherat, ingénieur géologue,ancien Ingénieur en chef des services de l'Etat)
Je retiens cette phrase si juste de Pierre Potherat :
Les hommes ont mis 60 ans à détruire ce que notre mère nature avait construit en 2 000 ans !

J'espère que les plus hautes instances de la Nation vont prendre conscience du danger qui menace nos rivières, nos ouvrages d'art, et donc de toute l'histoire si belle de nos campagnes.
Un sursaut rapide serait le bienvenu, ne croyez vous pas ?
-
Commentaires
en Bourgogne

la conclusion pourrait etre aussi de remeandrer les rivières sans avoir de seuil de moulins
un tracé rectiligne approfondi le fond de la rivière car augmente la pente entre un point A et B, si on remeandre, on remonte le fond car on allonge la distance entre ces points A et B